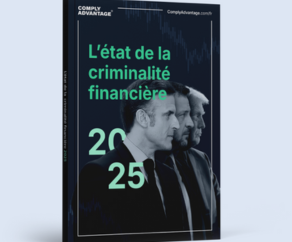Pour répondre aux violations du droit international, aux atteintes aux droits de l’homme, aux crimes commandités par l’État et aux menaces contre la sécurité internationale, les gouvernements imposent des sanctions contre des cibles désignées dans le monde entier. Ces sanctions constituent un ensemble de restrictions et de pénalités imposées à des pays, des entités ou des individus pour dissuader ces activités et résoudre les conflits géopolitiques sans recourir à une intervention militaire.
L’efficacité des sanctions dépend de la capacité du pays émetteur à les faire appliquer. Les organismes de réglementation, comme l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, publient des listes de sanctions identifiant les cibles désignées. Les pays assurent la conformité par le biais de réglementations et imposent des sanctions pénales en cas de violation.
Les individus et entités sanctionnés cherchent souvent à contourner les sanctions pour poursuivre leurs transactions financières. C’est pourquoi le filtrage des sanctions est crucial pour la conformité réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). Les institutions financières (IF) doivent comprendre leurs obligations de conformité, suivre l’évolution des sanctions et mettre en œuvre des mesures efficaces.
Quels sont les principaux types de sanctions ?
Les sanctions peuvent être primaires ou secondaires.
Les sanctions primaires restreignent les individus ou les entités relevant de la juridiction de l’émetteur. Par exemple, un citoyen américain ne peut pas faire affaire avec un établissement nord-coréen sanctionné.
Les sanctions secondaires ciblent les personnes extérieures à la juridiction de l’émetteur qui traitent avec des entités sanctionnées. Par exemple, une banque européenne risque des pénalités ou de perdre l’accès au système financier américain si elle effectue des transactions avec cet établissement nord-coréen.
Au-delà de ces deux types, les sanctions se répartissent en six catégories principales.
Sanctions économiques
Les sanctions économiques sont imposées à des pays, des institutions ou des individus pour restreindre leur capacité à mener des échanges commerciaux ou des transactions financières. Elles comprennent les embargos sur les importations et exportations, les interdictions commerciales et d’investissement, et les gels d’avoirs.
Sanctions diplomatiques
Les sanctions diplomatiques, moins sévères que les sanctions économiques, impliquent généralement la rupture des liens diplomatiques et l’expulsion des diplomates du pays émetteur des sanctions.
Sanctions militaires
Les sanctions militaires impliquent une intervention armée. Le recours à la force militaire étant fortement restreint par le droit international, ces sanctions sont plus rares et plus sévères. Les sanctions économiques ciblant les capacités militaires d’un pays, comme un embargo sur les armes, sont parfois aussi classées comme sanctions militaires.
Sanctions sportives
Les sanctions sportives empêchent les nations ciblées de participer à la scène sportive internationale : leurs athlètes ne peuvent pas participer aux événements et les compétitions ne peuvent pas se tenir dans les pays sanctionnés.
Sanctions environnementales
Les sanctions environnementales sont plus récentes que les autres types. Plutôt qu’une nouvelle catégorie en soi, elles constituent un mélange de sanctions économiques et diplomatiques spécifiquement liées aux infractions environnementales.

L'état de la criminalité financière en 2025
Téléchargez notre cinquième rapport annuel sur l'état du secteur, une feuille de route pour l’année à venir, élaborée à partir d'une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs en conformité.
Consultez le rapportComment fonctionnent les sanctions ?
À l’échelle mondiale, les sanctions sont établies et appliquées par divers organismes nationaux et internationaux, chacun selon ses propres conditions spécifiques. Voici les principaux organismes responsables de leur émission et application.
Sanctions de l’ONU
Les Nations Unies, en tant qu’organisme intergouvernemental mondial majeur, jouent un rôle central dans l’imposition de sanctions. Ces sanctions sont répertoriées dans la Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU) et s’appliquent à tous les États membres. L’ONU impose principalement des sanctions dans trois cas : violations du droit international, menaces contre la paix internationale et activités violentes au sein des États.
L’adoption des sanctions de l’ONU requiert un vote majoritaire des membres du CSNU. Ce conseil comprend cinq membres permanents (États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine et Russie) et dix membres non permanents en rotation. Chaque membre permanent dispose d’un droit de veto pouvant bloquer l’application des sanctions — comme l’a fait la Russie concernant la Corée du Nord. L’ONU ne disposant pas de pouvoir législatif direct dans les États membres, ce sont les autorités législatives nationales qui doivent mettre en œuvre les sanctions une fois adoptées.
Sanctions dans l’UE
L’UE impose diverses sanctions contre des cibles mondiales. Certaines sont appliquées directement par le droit communautaire, tandis que d’autres sont déléguées aux législateurs nationaux des États membres. Ces sanctions s’imposent à tous les individus et entités des 27 États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux citoyens de l’UE opérant dans le monde entier.
Le Conseil de l’UE met en œuvre les sanctions de l’ONU ainsi que ses propres sanctions autonomes, répertoriées dans la liste consolidée des sanctions de l’UE. Le régime de sanctions de l’UE n’a cessé d’évoluer : en mai 2019, l’UE a introduit un régime de sanctions contre la cybercriminalité, puis en décembre 2020, un régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme (GHRSR). L’UE dispose également d’un statut de blocage empêchant les personnes de l’UE de se conformer aux sanctions secondaires imposées par des pays tiers. L’application des sanctions relève de la responsabilité des États membres plutôt que d’une autorité centrale, et ces mêmes États membres sont chargés de sanctionner les infractions au régime.
Sanctions en 2024
En raison du grand nombre de régimes de sanctions actifs dans le monde et de l’ajout constant de nouvelles entités aux listes, il est impossible d’en dresser un inventaire exhaustif (l’UE maintient à elle seule 30 programmes de sanctions en août 2024). Néanmoins, certaines tendances clés méritent une attention particulière pour les IF en 2024.
Sanctions contre la Russie
Les sanctions contre la Russie dominent le paysage international depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, bien que certaines mesures soient déjà en place depuis 2014 en réponse à l’agression russe dans la région. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE, entre autres, ont imposé des mesures comprenant des sanctions étatiques et individuelles, des restrictions commerciales, des gels d’avoirs et des sanctions diplomatiques. Le Bélarus fait également l’objet de sanctions pour son soutien à la Russie.
Sanctions contre l’Iran
L’Iran fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis, de l’UE et de nombreux autres pays en raison de son programme nucléaire, son soutien militaire à la Russie et ses violations des droits de l’homme. Malgré un bref dégel après la levée de certaines sanctions par l’administration Biden dans le cadre d’une « approche de bonne foi », les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de contrer le développement des missiles nucléaires iraniens par des sanctions. Suite à l’expiration des sanctions de l’ONU en octobre 2023, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont intégré ces mesures dans leurs législations nationales.
Sanctions contre la Corée du Nord
Les sanctions contre la Corée du Nord, en vigueur depuis 2006, visent principalement ses essais d’armes nucléaires. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté plusieurs résolutions, tandis que la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont mis en place des sanctions supplémentaires. L’OFAC a publié des directives détaillées sur l’interprétation de ces sanctions et sur l’identification des techniques d’évasion.
Autres sanctions mondiales
- Sanctions contre les colons israéliens : Bien que l’État d’Israël ne soit pas visé, plusieurs individus et entités liés aux colonies de Cisjordanie sont sanctionnés par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.
- Sanctions contre le Venezuela : Le Venezuela fait l’objet de sanctions économiques et diplomatiques, principalement américaines, incluant des embargos commerciaux, des restrictions financières et des interdictions d’entrée.
- Sanctions contre le Myanmar : Les violations des droits de l’homme contre la minorité Rohingya ont conduit les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie à imposer des sanctions.
- Sanctions contre la Chine : Les États-Unis et l’UE ont ciblé des individus et organisations chinois en réponse à la production de fentanyl, la persécution des Ouïghours, le soutien à l’invasion russe de l’Ukraine et les violations des droits de l’homme à Hong Kong et au Tibet.
Filtrage des sanctions pour la LCB-FT
Les IF doivent mettre en place un filtrage efficace des sanctions pour éviter les conséquences réputationnelles et financières de la non-conformité. Voici les bonnes pratiques à suivre :
- Adopter une approche fondée sur le risque : Cette approche constitue la base de tout programme de conformité LCB. Elle permet aux IF de prioriser les clients les plus à risque dans leurs processus de filtrage et de surveillance. Les établissements doivent identifier leurs zones de risque principales selon leurs produits, services et profils clients, puis allouer leurs ressources de manière proportionnée — sans excès ni insuffisance.
- Adopter une approche de conformité à plusieurs niveaux : Les établissements doivent déployer une stratégie de filtrage des sanctions multifacette, combinant divers outils et processus pour ne pas dépendre d’une seule ligne de défense. Concrètement, cela implique la nomination d’un responsable conformité, la formation continue du personnel, la planification d’audits et l’utilisation de données complètes avec des logiciels spécialisés pour automatiser efficacement le filtrage.
- Utiliser des données de la plus haute qualité possible : Dans le cadre de la vigilance raisonnable (CDD), les IF doivent filtrer leurs clients par rapport aux listes de sanctions et de surveillance. Des informations précises, complètes et à jour sont essentielles. Les établissements doivent régulièrement actualiser leurs données et vérifier toute anomalie.
- Établir la propriété bénéficiaire effective (UBO) : Les personnes sanctionnées peuvent tenter de masquer leur identité en utilisant des réseaux d’individus et d’établissements pour leurs transactions. Les établissements doivent identifier l’UBO dès qu’un client pourrait agir pour le compte d’un tiers.
- Effectuer une surveillance continue : La conformité aux sanctions s’étend au-delà de l’entrée en relation d’affaires des clients, notamment en raison de l’évolution constante des listes de sanctions. Les transactions doivent être surveillées en permanence pour détecter toute implication d’entités sanctionnées, et toute activité suspecte doit être signalée aux autorités.
Solutions avancées pour le filtrage des sanctions
Les IF du monde entier s’appuient sur la rapidité, la précision et la simplicité du logiciel de filtrage des sanctions de ComplyAdvantage. Ses données, alimentées par une IA de pointe et affinées par des experts, dépassent les exigences réglementaires minimales en incluant les entités liées aux personnes sanctionnées, permettant ainsi une gestion proactive des risques.
En utilisant le logiciel de ComplyAdvantage, les IF peuvent :
- Obtenir des mises à jour des sanctions en temps quasi réel grâce à des données issues de multiples listes mondiales, actualisées automatiquement.
- Éviter les violations de sanctions grâce à des alertes configurables utilisant des algorithmes de pointe et une correspondance floue pour gérer les variantes de noms.
- Réduire les délais d’intégration jusqu’à 83 % grâce à une approche basée sur le risque et à la minimisation des faux positifs.
- Bénéficier de flux de travail intégrés efficaces, de la gestion des alertes jusqu’au traitement des cas, via les API REST.
- Examiner les alertes plus efficacement grâce à des profils clients consolidant les données de sanctions, de PPE, de listes de surveillance, de probité et de médias défavorables.
Faites de la conformité un avantage compétitif pour votre organisation
Renforcez votre organisation et stimulez votre croissance grâce à des solutions dynamiques adaptées à vos besoins. Réservez votre démo gratuite dès aujourd'hui et découvrez pourquoi des milliers d'établissements utilisent déjà ComplyAdvantage.
Obtenez une démonstrationPublié initialement 26 mars 2020, mis à jour 06 février 2025
Avertissement : Ce document est destiné à des informations générales uniquement. Les informations présentées ne constituent pas un avis juridique. ComplyAdvantage n'accepte aucune responsabilité pour les informations contenues dans le présent document et décline et exclut toute responsabilité quant au contenu ou aux mesures prises sur la base de ces informations.
Copyright © 2026 IVXS UK Limited (commercialisant sous le nom de ComplyAdvantage)